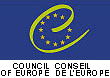| 4-5-6 Nov.
2003 Bordeaux (France) 1er Colloque International EUROPE/AMERIQUE 
Sans remonter à la période épique des années soixante, les années quatre-vingt dix et suivantes ont vu à l’IUT Michel de Montaigne (Université de Bordeaux 3) un renforcement lent, mais régulier de l’offre de formation professionnelle et universitaire à la fois pour ce qui concerne l’animation, en lien avec une demande du secteur professionnel régional et même au-delà, mais aussi avec nos partenaires des Fédérations d’Education Populaire, réunis pour la plupart au sein du Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire (CRAJEP). Il est sûrement utile de se souvenir ici que le Président du Conseil d’Administration de l’IUT est à la fois un militant et un professionnel de la Fédération Française des Maisons de Jeunes et de la Culture. Mais il n’y a pas que la formation qui s’est développée : colloques régionaux, publications, recherches, éditions d’ouvrages dans le champ de l’animation, du développement local, de la politique de la ville, de la culture, du sport, du tourisme, de la vie associative, des enjeux autour des équipements sociaux, culturels et sportifs dans le cadre de la « gouvernance » locale, création de collections dans des maisons d’édition locale et même nationale, interventions dans des colloques, séminaires ou sessions de formation sur le territoire national ou à l’étranger, etc. Ces évidents signes d’une vitalité théorique et pratique à la fois ne doivent pas cacher qu’il y a encore beaucoup à faire pour favoriser plus encore une perspective d’ouverture du champ de l’animation aux défis qui accompagnent les évolutions de nos sociétés. C’est donc pour capitaliser tout cet ensemble d’initiatives qu’est née, il y a maintenant plus de 2 ans et demi, l’idée de réaliser ce colloque international qui a été préparé par plusieurs missions à l’étranger, en Europe, en Amérique latine et au Canada: « seul le diable ne rêve pas », nous propose un proverbe kazakh. |
12 à 15
Sept. 2005 São-Paulo (Brésil) 2e Colloque International sur l'animation.
"CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE : |
26-27-28 Sept.
2007
"ANIMATION SOCIOCULTURELLE : Les modifications globales inondent le quotidien, et pratiquement rien ne les arrête. Existe-t-il au niveau local des possibilités d’organiser activement ces développements, de manière constructive? Le 3ème colloque international « Animation socioculturelle: enjeux locaux et globaux» se centre sur cette problématique et soulève des questions brûlantes. L'approche ascendante (de bas en haut) et participative de l’animation socioculturelle constitue-t-elle une réponse possible au défi lancé par les processus de modification globaux et locaux? Les relations sociales et les réseaux de communication tracent-ils un chemin hors de la perte croissante d'identité et de la division de notre société globale? La cohésion sociale à petite échelle est-elle la condition aux développements durables à grande échelle? Comment se présente le développement en Europe et de quelles expériences internationales pouvons-nous tirer des leçons? La solution nous conduit-elle au monde virtuel? Ou la discussion sur la participation et l'interconnexion n'est-elle qu'une nouvelle illusion ou l'expression du désarroi face au débat de la globalisation? Le 3ème colloque international s'inscrit dans la lignée des colloques précédents de Bordeaux (2003) et de São Paulo (2005) et soulève des questions critiques dans le contexte des développements globaux et locaux, pas seulement d’un point de vue théorique. Des projets concrets illustreront les défis à relever dans les régions urbaines, de même que des exemples ruraux. Des comparaisons internationales ouvriront la voie à des échanges réciproques et à des débats passionnants. La question du rôle et de l’importance de l’animation socioculturelle, soit d’un concept qui s’oriente sur des valeurs telles que la justice et l’intégration sociales, est au centre du débat. Ce colloque de 3 jours s'organise autour des thèmes suivants:
Des spécialistes des sciences humaines et sociales et des praticiens du monde entier sont invités à participer. Les inscriptions définitives seront possibles dès janvier 2007. Pour vous renseigner sur le projet, veuillez Cliquer ici. nouveau lien (allemand) :
|
28-29-30 Oct.
2009 INFORMATIONS GÉNÉRALESDu 28 au 30 octobre 2009, l’Unité des programmes d’animation et recherche culturelles de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) accueillera des chercheurs et professionnels de l’animation provenant des cinq continents. Ces spécialistes auront la chance de confronter et d’approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques de la créativité en animation autour d’enjeux organisationnels, identitaires et citoyens à partir de grandes conférences prononcées par une demi-douzaine d’invités réputés ainsi que dans le cadre de la tenue d’une trentaine d’ateliers thématiques. Suivant la tradition du Réseau international de l’animation (RIA) initiée à Bordeaux (France) en 2003 et poursuivie à Sao Paolo (Brésil) en 2005 puis à Lucerne (Suisse) en 2007, le 4e Colloque couvrira un très large éventail de thèmes et d’objets de recherche relevant des différentes formes d’animation, spirituelle, culturelle et socioculturelle. En accord avec les valeurs promues dans ce champ d’études et de pratiques, l’événement accordera une large place aux chercheurs établis ou en formation autant qu’aux professionnels d’expérience ou à ceux plus récemment engagés sur le terrain. Les langues utilisées lors du colloque seront le français, l’anglais et l’espagnol. Toutes les grandes conférences et certains ateliers seront traduits dans ces trois langues. Quelques ateliers privilégieront l’une ou l’autre de ces langues.
Lieu du colloque
Jean-Marie Lafortune
|
26-27-28 Octobre
2011 ZARAGOZA - ESPAGNE 5° colloque international sur l'animation
Animation,
VIDEO =>
VIDEO =>
Ce colloque sera le cinquième d’un cycle commencé à
Bordeaux en novembre 2003, à la suite duquel ont suivi ceux de Sao
Paulo en 2005, Lucerne en 2007 et Montréal en 2009. Ces colloques
ont servi comme point de rencontre entre des chercheurs, des
éducateurs et des gestionnaires du secteur de l’animation pour
discuter et réfléchir, ainsi que pour partager des découvertes et
détecter des évolutions.
Cette cinquième édition se déroulera pour la première
fois dans une ville espagnole: L’Institut d’Études Politiques et Sociales d’Aragon (organisation qui réunit des professionnels du domaine socio-éducatif, ainsi que des chercheurs et des professeurs d’université) est l’entité promotrice de ce 5ème Colloque. suite de la présentation.. cliquez
|
|
Bienvenue ! vous êtes le |
|
dernière mise à jour :
lundi 16 novembre20011- 21h |
Contact colloque et réseau international : |
|
|
|
|